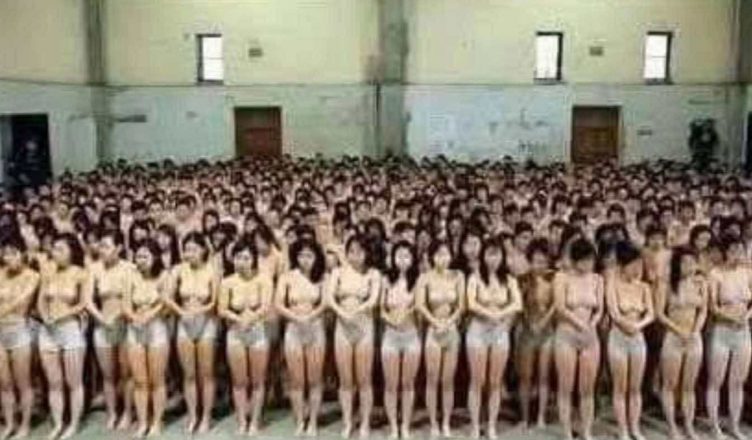Le froid qui régnait dans la pièce ne venait pas de la température, mais des regards. Des rangées ordonnées de jeunes filles en jupes grises étaient assises, immobiles comme des statues. L’air était lourd d’un mélange de sueur, de savon bon marché et de peur. Dans un coin, un homme en blouse blanche se tenait près de deux autres en uniforme. Il gardait la tête baissée, prenant des notes dans un carnet, et chacune d’elles le savait : une erreur ne coûtait pas une note, mais un avenir.
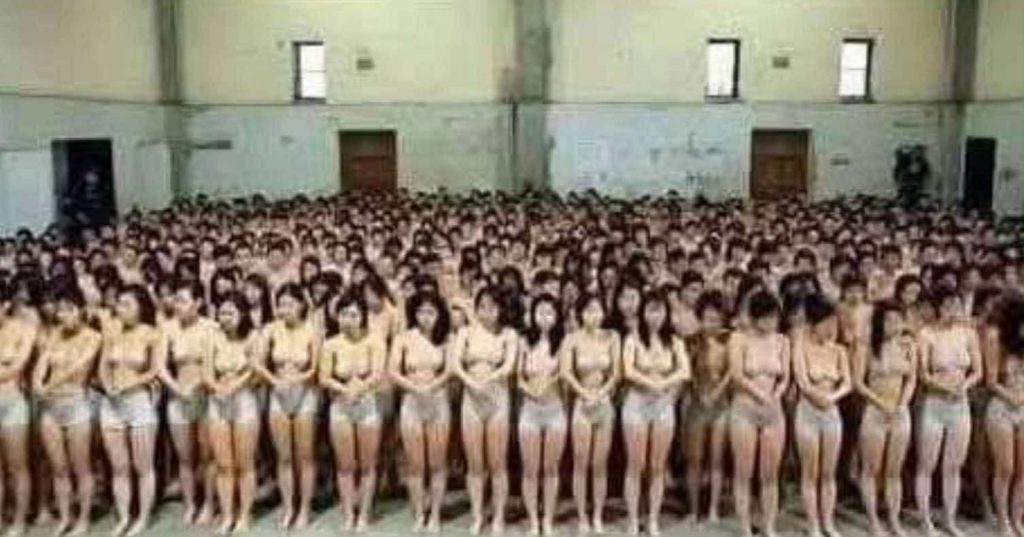
L’une d’elles était Ha Yeon, une étudiante de vingt ans. Lorsque la convocation pour l’« examen médical » arriva, sa mère lui murmura : « Ne pose pas de questions. Souris simplement. » La jeune fille s’avança dans un couloir dont les murs étaient peints de la même couleur que les visages des examinateurs : décolorés, immaculés. La rumeur courait : parfois, un examen pouvait décider qui intégrerait un institut d’élite et qui disparaîtrait dans un camp de travail.
On commença par mesurer sa taille et son poids. Puis ils l’ont forcée à se déshabiller jusqu’à ses sous-vêtements. Le froid lui transperçait les os, mais le regard des hommes en uniforme était encore plus intense. « Retournez-vous. Levez les mains. Regardez droit devant vous. » Ces mots sonnaient comme une injonction. Elle se tenait au milieu de la pièce, comme sur une scène sans spectateurs, face à des juges.
« Pourquoi tout ça ? » s’exclama la jeune fille à côté d’elle.
« Pour savoir à qui appartient votre corps », répondit Ha Yeon d’une voix calme.
Officiellement, il s’agit de soins préventifs, de soins de santé, d’un programme gouvernemental. En réalité, c’est un outil de contrôle. Les médecins ne se contentent pas de mesurer, ils classent. Le corps devient un dossier où chaque grain de beauté, chaque centimètre, est enregistré et évalué comme une propriété. Ceux qui sont jugés « imparfaits » retournent rarement à leurs études ou à leur travail précédents.
Parfois, l’« examen » se termine par une proposition de rester dans la « fonction publique ». Cela ressemble à une opportunité, mais en réalité, cela signifie une chose : la jeune fille se retrouve prise au piège d’un système fermé de « services destinés aux hauts fonctionnaires ». Là-bas, la santé n’est pas une fin en soi, mais une marchandise.
Au beau milieu de la procédure, les lumières s’éteignirent soudainement. Les jeunes filles échangèrent des regards. Quelqu’un cria. Une minute plus tard, la lumière se ralluma et le fonctionnaire, avec un sourire narquois, lança : « Voyons qui gardera son sang-froid. »
C’est alors que Ha-young comprit pour la première fois : ici, on n’étudiait pas la santé, mais l’obéissance. Le jargon médical n’était qu’une façade dissimulant un entraînement.
« Le corps n’appartient-il pas à l’individu ? » pourriez-vous demander. En Corée du Nord, la réponse est tout autre : le corps fait partie de l’État, au même titre qu’un bâtiment, une usine ou un drapeau. Dès leur naissance, les citoyens apprennent que même leur sang est une ressource, et non une propriété.
Parfois, les jeunes filles sont contraintes de subir un second examen, une « vérification des données ». Elles sont photographiées, mesurées, leur peau, leurs dents, jusqu’à leur démarche, sont examinées. Le moindre écart peut entraîner une « réaffectation ». Officiellement, on parle de « répartition selon les besoins de la Patrie ». Officieusement, il s’agissait d’un processus de sélection pour les maisons de retraite huppées, où de jeunes femmes étaient au service des « hauts pontes ».
Ha-young s’efforçait de ne pas y penser. Elle rêvait de devenir médecin – d’aider les gens, pas de les briser. Mais ce jour-là, elle sentit que la médecine, ici, n’était pas une science, mais un instrument de pouvoir.
Plus tard, à l’étranger, elle confia aux journalistes : « Ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains. Ils nous considéraient comme des cobayes. Comme s’ils ne testaient pas nos cœurs, mais la qualité de notre matière.» Sa voix tremblait, non de peur, mais de souvenirs.
Le paradoxe de cette histoire, c’est que nombre de ceux qui menaient ces « examens » étaient eux-mêmes prisonniers du système. Les médecins savaient qu’ils participaient à cette humiliation, mais refuser revenait à disparaître. Ils signaient, se détournaient et gardaient le silence. Ce soir-là, quand Ha-young rentra chez elle, sa mère l’accueillit à la porte et lui demanda :
« Tout s’est bien passé ? »
« Oui », répondit-elle. Mais dans le miroir, elle vit un visage étrange : calme, tendu, comme ceux qui ont appris à survivre sans vivre.
Depuis, Ha-young n’arrive plus à regarder sereinement les blouses blanches. Elle imagine ce hall, les pas réguliers, le froissement du papier. Parfois, elle rêve qu’elle se trouve à nouveau au centre, et que les lumières s’éteignent. Elle voudrait crier, mais elle n’y arrive pas – ses lèvres lui semblent étrangères.
Peut-on s’approprier son corps sans verser de sang ? Oui. Il suffit de convaincre la personne qu’il ne lui appartient plus.
La Corée du Nord ne se contente pas de construire des murs, elle érige aussi des frontières au sein même des individus. Là-bas, le personnel devient public, l’intime un rapport, la douleur une statistique. Mais tout contrôle a ses limites : si le corps peut être enregistré, l’âme, elle, ne peut l’être.
Et pourtant, lorsqu’elle voit des photos de nouvelles générations de filles en uniformes gris, assises en rangs serrés, elle a l’impression que le passé se répète. Seuls les visages diffèrent, mais la peur est la même.
Elle se souvient de cette pièce froide, de l’odeur de savon et de gomme, du crissement du crayon sur le papier – et pense :
« Alors j’ai compris qu’une personne commence là où la peur s’arrête.»
Mais en Corée du Nord, la peur est l’unité de mesure officielle.
…Et tandis que les corps restent la propriété de l’État, les âmes continuent de chercher un moyen de reconquérir le droit de respirer.
La première scène est l’engourdissement, la dernière l’épiphanie. Tout le reste se situe entre la respiration et son absence.